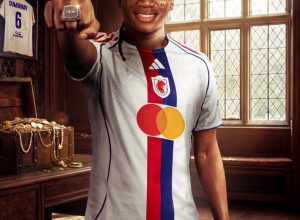Dans sa lutte contre l’insécurité, l’État haïtien a mis en place, à partir de 2006, une structure dénommée la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion (CNDDR), dont la mission est de coordonner et de mettre en œuvre la politique de l’État en matière de désarmement, de démantèlement des groupes armés et de réinsertion des individus désarmés. Dix-neuf ans plus tard, les groupes armés sont non seulement mieux équipés, mais aussi plus riches grâce à leurs activités illicites. Face à cet état de fait, peut-on vraiment envisager une réelle réinsertion de ces gangsters dans le contexte actuel ?
Fouye Rasin Nou, le 2 mai 2025 — Créée sous la présidence de René Préval, cette structure a été réactivée à plusieurs reprises, notamment en mars 2019, sous l’administration du feu président Jovenel Moïse, par un décret présidentiel du 8 mars 2019. Plus récemment, en mars 2025, une nouvelle version de la CNDDR a été installée pour renforcer les efforts de lutte contre l’insécurité et favoriser la réintégration des jeunes impliqués dans des activités illicites. Cependant, si le mot « réinsertion » semble beau et inspirer l’espoir, la réalité quotidienne impose des doutes légitimes quant à la réalisation de ce vœu.

Tout d’abord, force est de constater que depuis 2020, les gangs contrôlent une bonne partie de la capitale et imposent leurs lois. En 2025, la coalition criminelle Viv Ansanm contrôle plus de 80 % de la capitale et les principaux axes routiers menant à celle-ci, malgré la présence de la police, de l’armée d’Haïti et de la mission multinationale de soutien à la sécurité.
Eu égard à leur présence et nonobstant le kidnapping et les vols, ils rançonnent les chauffeurs de transport en commun et ceux transportant des marchandises. Selon le ministre de l’Économie et des Finances, Alfred Metellus, intervenant à la radio Magik 9, le 30 avril 2025, les gangs armés parviennent à générer plus de 100 millions de dollars américains chaque année, rien que sur la frontière haïtiano-dominicaine. À cela, on peut ajouter les rançons perçues sur les axes routiers qu’ils contrôlent. À titre d’exemple, selon le témoignage d’un chauffeur de bus faisant le trajet Jacmel-Port-au-Prince, ce dernier devait payer 3000 gourdes à la bande à Chrisla et 5000 gourdes à celle à Izo à l’aller comme au retour, soit 16 000 gourdes pour un aller-retour. Si l’on suppose qu’au moins 50 bus font ce trajet par jour, cela équivaudrait à 800 000 gourdes par jour au minimum, soit 292 millions de gourdes par an, rien que sur la route de Martissant. Ce calcul, qui résulte d’une supposition, ne prend même pas en compte tout le trafic concernant les camions de marchandises et tous les véhicules venant du Sud et de la Grande Anse.

Hormis cette force économique des gangs, l’État lui-même fuit. Les bâtiments publics se vident et les autorités étatiques préfèrent délocaliser les bureaux. Cela a pour conséquence de renforcer la confiance des gangs, qui pillent et gagnent plus de territoires.
Face à ce constat, peut-on réellement envisager la réinsertion sociale de ces individus qui gagnent des millions de gourdes par jour, facilement, face à un État failli ? L’État espère-t-il vraiment voir les chefs de gangs déposer les armes et s’intégrer par magie à la société, abandonnant l’argent facile pour un travail normal ?
Par ailleurs, la réinsertion suppose aussi la création d’un cadre de vie conforme, dans lequel l’individu pourrait trouver des alternatives viables pour abandonner son ancienne vie. Or, l’État haïtien, miné par la corruption, n’a jamais mis en place un plan de société et de développement économique durable capable de répondre aux besoins fondamentaux de la population. Donc, sans repères solides et sans opportunités réelles, les individus armés seraient peu enclins à s’intégrer, ayant passé trop de temps à vivre de l’argent facile.
De plus, si les gangs armés ne se sentent pas menacés dans leurs certitudes de contrôle, la réinsertion serait un vœu pieux pour l’État. Il faudrait, pour cela, une véritable politique d’éradication des gangs armés et des actions concrètes, coordonnées, afin de pousser les bandits à déposer les armes sous peine de mourir. Or, dans l’état actuel des choses, les autorités étatiques ne montrent pas de signes visibles de cette volonté d’éradiquer ce fléau. Au contraire, elles fuient et se déresponsabilisent face à la terreur des gangs. Les interventions des forces de l’ordre s’apparentent à des actions ponctuelles, ne répondant pas à un plan cohérent de sécurité. De toute façon, comment peut-on penser à un plan cohérent quand le Premier ministre, chef du CSPN, est en désaccord constant avec le directeur général de la police ?
En somme, le problème de la réinsertion sociale des gangs armés est complexe et nécessite des prérequis que les autorités actuelles se montrent incapables de garantir. En ce sens, l’idée même de la réinsertion semble une chimère, un leurre parmi d’autres d’un État failli dont les priorités sont aux antipodes de celles de la population.
Domond Willington / Fouye Rasin Nou (FRN)