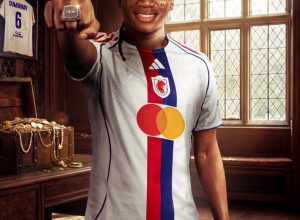Longtemps reléguées aux marges des récits officiels, les femmes de la Révolution haïtienne ont pourtant joué un rôle central dans la lutte contre l’esclavage et pour l’indépendance. De Sanité Bélair à Catherine Flon, de Cécile Fatiman à Marie-Claire Heureuse, elles ont combattu, soigné, guidé et inspiré. Elles ont affronté l’armée napoléonienne, cousu le drapeau national, soigné les blessés, ravitaillé les troupes et invoqué les esprits pour soulever un peuple.
Pourtant, ces femmes de la Révolution haïtienne restent largement invisibles dans la mémoire collective. Ce dossier revisite leur rôle décisif, trop souvent effacé, dans la conquête de l’indépendance d’Haïti, en s’appuyant sur les travaux d’historiennes comme Carolyn Fick, Joan Dayan, ainsi que sur les recherches de l’historien haïtien Jean Fouchard, auteur des Marrons de la liberté (1972), et sur des récits oraux collectés dans les archives du Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH).
Fouye Rasin Nou, le 13 août 2025 – En 1802, sous un ciel lourd de menace, Sanité Bélair se tient droite face à ses bourreaux français. Refusant de s’agenouiller, elle incarne la révolte d’un peuple décidé à briser les chaînes de l’esclavage. Comme elle, des dizaines de femmes haïtiennes, combattantes, prêtresses vodou, stratèges, ont porté la Révolution haïtienne (1791-1804), le premier soulèvement d’esclaves victorieux menant à la création d’Haïti, la première république noire indépendante.
Longtemps éclipsées par les figures masculines comme Toussaint Louverture ou Jean-Jacques Dessalines, ces actrices, révélées par des historiennes comme Carolyn Fick et Joan Dayan, ont été le cœur battant d’une lutte collective pour la liberté.
Le contexte de Saint-Domingue : une colonie d’oppression
À la fin du XVIIIe siècle, Saint-Domingue était la colonie la plus prospère et la plus brutale de l’empire français, produisant près de 40 % du sucre mondial grâce au travail de près de 500 000 esclaves, majoritairement africains. Les conditions de vie dans les plantations étaient inhumaines : travail forcé sous un soleil écrasant, châtiments corporels fréquents et espérance de vie réduite. Les femmes, en particulier, subissaient des violences spécifiques, des abus sexuels aux séparations familiales. C’est dans ce contexte d’extrême oppression que les femmes haïtiennes, qu’elles soient esclaves, affranchies ou métisses, ont forgé des stratégies de résistance, transformant leur marginalisation en une force révolutionnaire.
Femmes en résistance dans la colonie la plus brutale
Dans la colonie de Saint-Domingue, l’une des plus brutales du système esclavagiste français, les femmes, qu’elles soient esclaves noires, affranchies ou métisses, étaient doublement opprimées par les hiérarchies de race et de genre. Reléguées aux champs, aux tâches domestiques ou aux marges de la société, elles ont pourtant transformé ces contraintes en espaces de résistance. En tant que combattantes, soignantes ou prêtresses vodou, elles ont défié l’ordre colonial, prouvant que la révolution ne pouvait triompher sans leur apport.
Combattantes de la liberté
Sanité Bélair incarne la force indomptable des femmes haïtiennes. Lieutenante dans l’armée indigène, elle combattait aux côtés de son mari, Charles Bélair, et dirigeait elle-même des offensives contre les troupes napoléoniennes. Capturée en 1802, elle refusa de s’agenouiller face à ses bourreaux, choisissant de mourir debout, défiant ainsi l’ordre colonial et patriarcal.

« Sanité Bélair ne fut pas seulement une épouse de général, mais une meneuse militaire dont la bravoure galvanisa les insurgés face à l’armée napoléonienne. »
(Carolyn Fick, The Making of Haiti, 1990)
Si Sanité Bélair symbolisait la résistance armée, Marie-Jeanne Lamartinière illustrait le courage au cœur des batailles. Lors du siège de Crête-à-Pierrot en 1802, Marie-Jeanne Lamartinière s’est distinguée par son courage exceptionnel. Revêtue d’un uniforme militaire, sabre à la main, elle ne se contentait pas de soigner les blessés : elle combattait au front, galvanisant les troupes par ses chants de guerre. Un témoin de l’époque, cité par Micheline M. Gélinas, la décrivit comme « une lionne au combat, brandissant son sabre et chantant pour insuffler du courage aux soldats épuisés ».
Grann Tòya (Victoria Montou)
Grann Tòya, de son vrai nom Victoria Montou
(également appelée Adbaraya Toya, Toya Mantou ou « Tante Toya », et dont le nom est parfois orthographié « Victoria Montout »)

Née vers 1739 au Dahomey, territoire réputé pour ses guerrières amazones, et morte le 12 juin 1805 à Port-au-Prince, Victoria Montou, surnommée Grann Tòya, compte parmi les héroïnes majeures de la Révolution haïtienne (1791-1804). Enlevée, réduite en esclavage et déportée à Saint-Domingue, elle est formée dès l’enfance aux techniques de combat africaines et se distingue rapidement par son courage, sa discipline et son autorité naturelle.
Avant l’insurrection, elle vit et travaille sur la plantation d’Henry Duclos aux côtés de Jean-Jacques Dessalines. Tous deux développent un lien profond qu’il exprimera plus tard en l’appelant « tante », appellation de respect et de proximité dans la tradition africaine, sans lien biologique avéré. Sur cette plantation, elle l’initie au combat rapproché et au maniement des armes blanches, notamment le lancer de couteaux. Craignant leur influence mutuelle, Duclos les sépare, transférant Toya chez la famille Déluger et vendant Dessalines à un affranchi noir.
Durant la guerre, elle dirige des troupes avec fermeté, parfois en première ligne, et, à au moins une occasion documentée, elle commande directement des soldats au combat. À la tête d’une cinquantaine d’insurgés, elle répartit les tâches stratégiques : déboisement, labour, récolte et stockage des vivres, avec la précision d’un officier aguerri. Reconnue pour son intelligence, sa voix puissante et son charisme, elle galvanise ses hommes et femmes par son exemple.
Guerrière mais aussi guérisseuse et sage-femme, elle soigne les blessés et renforce la cohésion des insurgés. En 1804, en reconnaissance de son engagement, Dessalines la nomme duchesse impériale. Elle reçoit des funérailles d’État à sa mort en 1805, honneur rare réservé aux grandes figures nationales
Aujourd’hui, Grann Tòya demeure célébrée comme l’une des mères fondatrices d’Haïti, symbole d’une résistance féminine déterminante dans la naissance de la première république noire indépendante.
Catherine Flon : architecte du drapeau et de l’unité

Catherine Flon est célèbre pour avoir cousu le premier drapeau haïtien en 1803, un acte symbolique marquant la rupture avec la colonisation française. Cependant, Micheline M. Gélinas révèle que Flon jouait également un rôle stratégique dans les réseaux de communication entre les armées indigènes. En arrachant le blanc du tricolore français pour créer un drapeau bleu et rouge, elle a symbolisé l’union entre Noirs et Métis, posant les bases d’une identité nationale haïtienne.
Marie Sainte Dédée Bazile, dite Défilée-la-Folle : gardienne de la mémoire

Marie Sainte Dédée Bazile, née Rosalie Bosquet et surnommée Dédée Bazile, dite Défilée-la-Folle, incarne le courage des femmes qui ont préservé la mémoire de la révolution. Après l’assassinat de Jean-Jacques Dessalines en 1806, elle brava les interdits pour récupérer son corps mutilé et lui offrir une sépulture digne, un acte chargé de symbolisme. Elle joua également un rôle logistique, ravitaillant les troupes et transmettant des informations. Comme l’explique Joan Dayan dans Haiti, History, and the Gods (1995), son surnom reflétait une tentative coloniale de diminuer une femme trop indépendante. Elle symbolise la force des femmes haïtiennes dans la préservation de l’honneur et de l’héritage révolutionnaire.
Du champ de bataille aux autels vodou : les prêtresses vodou
Le vodou fut un moteur essentiel de la Révolution haïtienne, et les femmes y jouèrent un rôle central en tant que cheffes spirituelles et stratèges. Cécile Fatiman, prêtresse vodou, marqua l’histoire lors de la cérémonie de Bois-Caïman en 1791, où elle présida un rituel scellant le serment de révolte contre l’esclavage. Selon Jean Casimir dans La Culture opprimée (1971), le vodou n’était pas seulement une pratique religieuse, mais un « outil politique de mobilisation », où les prêtresses utilisaient chants, danses et invocations pour unifier les insurgés et renforcer leur détermination.
D’autres figures comme Marie-Louise Coidavid, future reine d’Haïti sous le nom de Marie-Louise Christophe, ont également mobilisé les communautés à travers des rituels qui transcendaient les divisions sociales. Par exemple, elle supervisa la création d’écoles pour les filles dans le royaume du Nord, une initiative rare à l’époque, qui visait à éduquer les jeunes Haïtiennes et à renforcer l’unité nationale. En incarnant des lwas comme Erzulie Dantor, protectrice des opprimés, ou Gran Brigit, esprit redouté associé à la justice et à la mort, ces femmes donnaient un sens spirituel et politique à la lutte, transformant chaque cérémonie en un acte de résistance. Gran Brigit, souvent invoquée dans les moments de tension, symbolisait une rétribution implacable contre les oppresseurs, rappelant aux insurgés que leur combat était aussi soutenu par le monde invisible.
Marie-Claire Heureuse : une héroïne de l’humanité

Épouse de Jean-Jacques Dessalines, Marie-Claire Heureuse n’était pas seulement une figure de l’ombre. Pendant la révolution, elle risquait sa vie pour soigner les blessés, nourrir les combattants et protéger les civils pris dans la tourmente des combats. Par exemple, elle organisait des distributions de vivres dans les camps, redonnant espoir aux insurgés épuisés. Après l’indépendance de 1804, elle s’est battue pour un Haïti plus juste, plaidant pour la réconciliation et un État qui protège tous ses citoyens. Sa compassion et son courage en font une figure essentielle de la révolution.
Une révolution exceptionnelle dans l’histoire mondiale
À l’échelle mondiale, le rôle des femmes haïtiennes dans la révolution se distingue par son ampleur et sa diversité. Contrairement aux femmes de la Révolution française, souvent cantonnées à des rôles symboliques comme Marianne ou à des actions de soutien, les Haïtiennes comme Marie-Jeanne Lamartinière prenaient les armes, tandis que des prêtresses comme Cécile Fatiman exerçaient un pouvoir spirituel et politique. Cette participation active, dans un contexte où elles défiaient à la fois le racisme colonial et le patriarcat, fait de leur contribution une exception dans l’histoire des luttes anticoloniales.
Un héritage vivant à transmettre
L’héritage des héroïnes de la Révolution haïtienne continue d’inspirer la culture, les luttes sociales et les mouvements citoyens d’aujourd’hui. Dans la littérature contemporaine, des œuvres comme Rosalie l’Infâme d’Évelyne Trouillot ou les essais de Myriam Chancy ravivent ces figures féminines et leurs combats. Sur le terrain, de nombreuses organisations de défense des droits des femmes, en Haïti comme dans la diaspora, perpétuent cet esprit de résistance en œuvrant pour la justice sociale, la lutte contre les violences de genre et l’émancipation des femmes.
De même, divers événements culturels et rituels vodou, tels que le festival de Souvenance à Gonaïves ou d’autres célébrations spirituelles à travers le pays, rendent hommage à l’héritage des prêtresses et à leur rôle dans la construction d’une conscience collective. À travers ces initiatives variées, c’est tout un peuple qui continue de faire vivre la mémoire de ces héroïnes, en s’appuyant sur leur exemple pour façonner un avenir plus juste, plus égalitaire et plus enraciné dans ses propres valeurs.
Pour ne plus les oublier
Malgré leur rôle fondamental, les combattantes et stratèges de la Révolution haïtienne ont été reléguées à l’ombre des récits officiels. Aujourd’hui, grâce aux travaux d’historiennes comme Carolyn Fick, Évelyne Trouillot et Myriam Chancy, leurs voix résonnent à nouveau, rappelant que l’indépendance haïtienne fut l’œuvre d’un peuple uni, où les femmes furent des actrices essentielles. Pour honorer leur mémoire, lisons leurs histoires, soutenons les musées haïtiens et partageons leurs luttes pour inspirer les générations futures. Leur courage, leur résilience et leur vision continuent de façonner l’identité de la première nation noire libre du monde, à l’image des fourmis patientes qui, grain après grain, bâtissent un édifice plus solide que la tempête.
Jean-Pierre Styve / Fouye Rasin Nou (FRN)